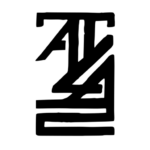Des cheminées crachant des déjections noires. Des rivières, teintées d’un vert fluoré, où le seul témoignage de vie est le corps désolé de poissons étonnement immobiles. Des forêts déracinées, où les souches laissèrent places à des champs génériques et interminables. Des prairies dorénavant emprisonnées sous un lourd manteaux bitumineux sur lequel la naguère faune se retrouve exposée, aplatie par des machines toujours plus pressée. Un océan, vide, où les poissons capturés laissent place aux vagabonds plastiques ; les coraux, eux évanouis, s’ensevelissent sous une marée d’algues conquérant les sols marins.
Comment regarder ce tableau sans comprendre que le vrai parasite en ce monde est l’humain, guidé seulement par ces pulsions et ses vices ? Egoïste, avare, il désire accumuler sans cesse dans le vain objectif d’obtenir un plus qui n’est jamais assez ; ainsi devons-nous conquérir, abattre, éventrer, transformer, afin d’obtenir, grandir, racheter, s’expandre. De cette triste conclusion, on en déduit la nature humaine, sans comprendre que celle-ci est le pure fruit du système dans lequel elle est baignée.
L’humain est un créateur par essence, ce qui le différencie de Dieu est la conscience de son pouvoir. S’il possède une base biologique, il ne lui est pas enchainée pour autant. Soit, ces besoins doivent être accomplies. Certes, son corps possède des caractéristiques immuables, des limites naturelles exprimées par ses gênes. Mais ce n’est pas une frontière infranchissable, car la culture dans laquelle l’humain évolue est créée de toute pièce, par ses valeurs, sa culture, par l’histoire de son peuple. Des milliers d’autres systèmes aurait pu exister, des milliers d’autres sont prêt à le remplacer.
La culture imprègne l’individu et, baignée en son sein, il en porte sa marque. Si chacun détient ses idées, son caractère, ses peines comme ses félicités, la société les imprègnent également. On ne peut séparer culture et biologie, celles-ci sont non seulement complémentaires, mais aussi indissociables que le serait la graine de la terre ; la première ne peut exister sans la seconde qui, sitôt que la première croît, se voit modifiée en conséquence. Si généralement on considère la culture comme le propre d’une société, d’une civilisation, d’une entité nationale, celle-ci est également présente à plus petite échelle, au sein des villes, de ses quartiers, dans un groupe d’ami, au sein d’une famille, voire même dans un groupe de travail. Pour cette raison, la société ne possède pas un paradigme uni, parce que plusieurs « dialectes » culturels s’expriment. Il en va de même pour les villes et les régions qui, selon la zone ou le quartier, changent complètement d’identité.
Ainsi, sans rentrer dans un nihilisme déterminée et contre-productif, ce qui est bon ou mauvais n’est qu’une décision sociétale. Une pratique réprouvée par la société, par la communauté, sera décriée comme mauvaise. Ce qui différencie l’assassin du soldat est l’approbation de collectivité ou de l’Etat. Si une essence de la bonté existait, elle serait partagé par tous les peuples. Or, toutes les collectivités n’ont pas les mêmes valeurs, et donc, la même vision des événements. Le cas simpliste d’une guerre expose un exemple. Aux pays gagnants, les soldats victorieux sont érigés en héros du peuple, et pourtant, ceux-ci sont caractérisée de barbares au sein du pays ravagé ; l’événement est le même, mais les interprétations de celui-ci, invoqués selon des principes universels, sont antagonistes, et à juste titre. Cette différence de perceptions est aussi présentes dans l’analyse des coutumes étrangères. La morale est construite par un peuple, ses pratiques seront celles sacralisées ; celles des autres, trop différentes, seront peu comprises, parfois déniées, jusqu’à traité l’altérité de barbare, de sauvage, d’incivilisée. De même, une société évolue, et avec elle ses valeurs. Des individus peuvent avoir non seulement un mode de vie radicalement différent de leurs ancêtres, mais agir selon des valeurs, une soi-disant nature, significativement altérées, parfois même antagonistes. On ne peut défendre une nature humaine universelle sans prétendre que la morale soit elle aussi également partagée entre tous les humains. Est moral ce qui est naturellement bon, est immoral ce qui s’écarte de la nature humaine.
Pourtant, si une nature humaine existe, en tant qu’essence de l’existence humaine, celle-ci devrait autant rester inchangée au fil du temps que partagée également entre tous les membres de l’espèce humaine. Or, toutes les sociétés qui ont existées ne cherchèrent pas nécessairement l’accumulation. De même, certaines sociétés existantes ne quêtent pas incessamment la richesse. Ces mêmes sociétés prouvent que l’humain peut vivre en harmonie avec son environnement, que marcher n’est pas synonyme de raser.
Argumenter que la nature humaine est avare et accumulatrice, c’est conclure que le système néolibéral est naturel, qu’il est la fin logique et inéluctable de toute société. Or, ce système économique est un système parmi tant d’autres possibles. Cette narrative est une aubaine pour le système actuel, parce qu’en imposant l’avarice à la nature humaine, elle condamne toute réflexion pour l’établissement du système de demain. L’humain n’est bon ni mauvais, n’est avare ni philanthrope, ou du moins, il n’est pas que ça ; il dépasse tout qualificatif unique. L’humain est animal et culture, émergeant du premier, il est nourrit par le second. Fruit de son temps, ses couleurs seront celles de son système. Aujourd’hui, sa nature est à l’accumulation, demain elle le sera à autre chose. Ne confondons pas les désirs et l’essence, le robinet et l’océan.