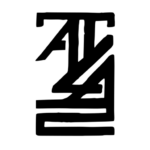Narration – De la richesse des échanges
Un jour exista des êtres qui jamais ne connurent la monnaie. Mais comment se passer de ce bien si central, non seulement pour nos échanges, mais également pour notre vie en société. Laissons parler ceux qui l’ont connu. Ils nous montreront l’histoire de la monnaie.