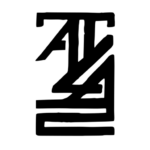Pour Boltanski et Chiapello, l’histoire du capitalisme est celle des justifications. Parce que l’accumulation n’est pas naturelle, et que les inégalités criantes le sont encore moins, le système doit justifier son état afin que se poursuive le profit. Dans cette optique, les colonies ne sont pas pillées, mais civilisées, le marché acquière des lois allant au-delà du hasard, et la reproduction des richesses n’est que le fruit du mérite, parce qu’au fond, tout le monde possèderait les mêmes opportunités, il suffit de le vouloir, de travailler ardemment ; que la méritocratie soit, et les inégalités furent justifiées.
Cette capacité d’adaptation peut également émaner de la nécessité pour la classe dominante de permettre à la classe dominée un certain niveau de vie, et ce, afin que la domination se perpétue. C’est la théorie de Gramsci, parce que la position de l’un est justifié par celle de l’autre. Si le dominé dépérit, il ne fait que précéder le dominant, ainsi tôt compromis. Même si la question de servitude volontaire est remise en question, surtout à l’aune du capitalisme néolibéral (Lordon, 2013), cette dépendance du dominant aux dominés est déjà traité par la Boétie ou Hegel, il y a déjà des siècles de cela.
Pour Boltanski et Chiapello, l’histoire du capitalisme est celle des justifications. Parce que l’accumulation n’est pas naturelle, et que les inégalités criantes le sont encore moins, le système doit justifier son état afin que se poursuive le profit. Dans cette optique, les colonies ne sont pas pillées, mais civilisées, le marché acquière des lois allant au-delà du hasard, et la reproduction des richesses n’est que le fruit du mérite, parce qu’au fond, tout le monde possèderait les mêmes opportunités, il suffit de le vouloir, de travailler ardemment ; que la méritocratie soit, et les inégalités furent justifiées.
Cette capacité d’adaptation peut également émaner de la nécessité pour la classe dominante de permettre à la classe dominée un certain niveau de vie, et ce, afin que la domination se perpétue. C’est la théorie de Gramsci, parce que la position de l’un est justifié par celle de l’autre. Si le dominé dépérit, il ne fait que précéder le dominant, ainsi tôt compromis. Même si la question de servitude volontaire est remise en question, surtout à l’aune du capitalisme néolibéral (Lordon, 2013), cette dépendance du dominant aux dominés est déjà traité par la Boétie ou Hegel, il y a déjà des siècles de cela.
Ne pouvant se passer des salariés, les patrons se voient obligés d’améliorer leur niveau de vie, de se plier à leurs revendications, sans quoi leurs positions se verraient menacées. Ainsi, quitte à accepter les revendications des salariés, autant instituer un marché, les muter afin qu’elles favorisent l’instauration de la même logique d’accumulation aliénant autant le patronat que les salariés ; les premiers viciés par le gain, les seconds vissés à un travail désœuvrant. Ironiquement, c’est quand les salariés pensent être le plus libres, les plus satisfaits, qu’ils sont au plus enchainés à leur système. Le néolibéralisme recréa l’artisanat, un artisanat corporatif, où la réalisation personnelle, si elles se font au sein du travail, est vouée au profit d’instances globalisées et impersonnelles.